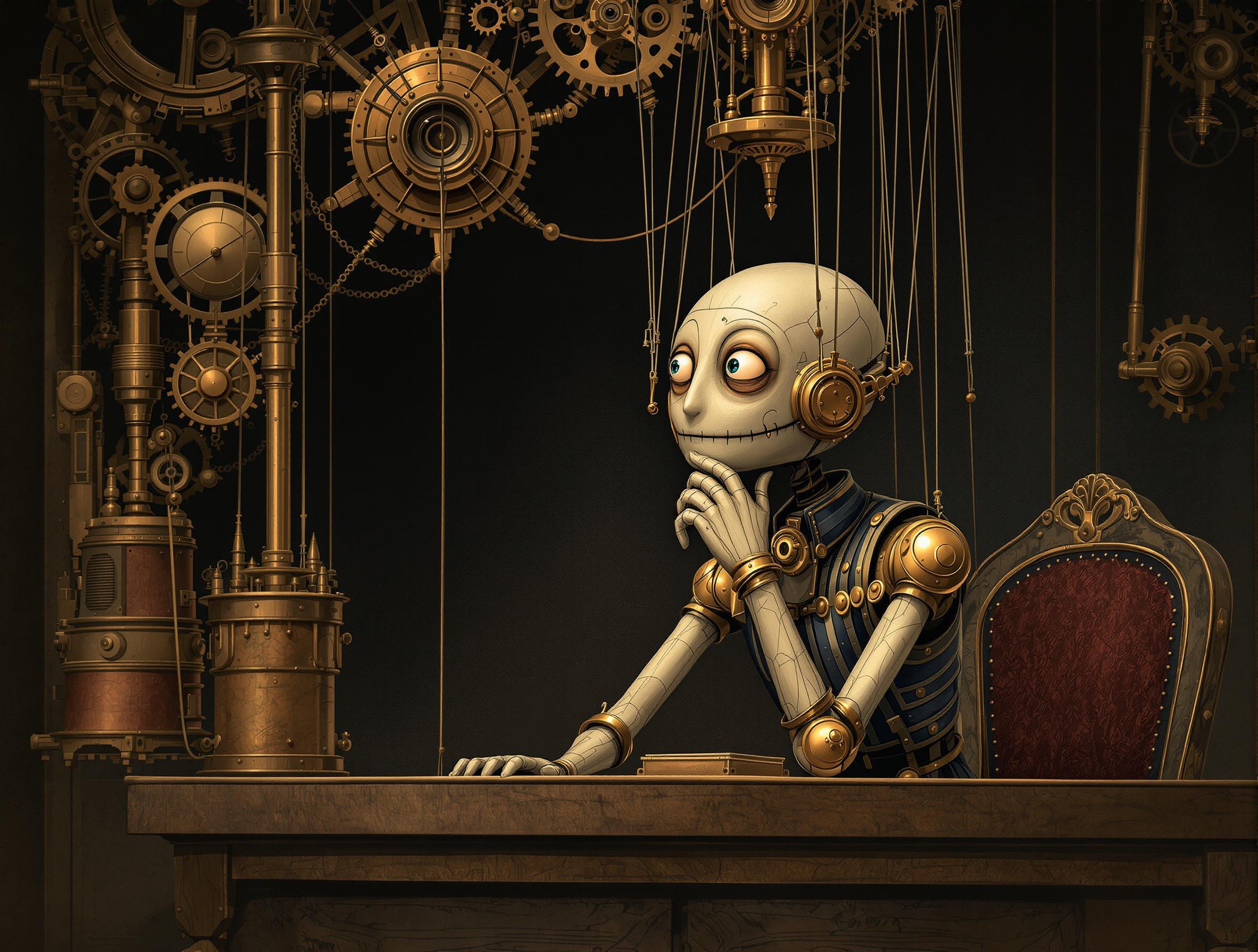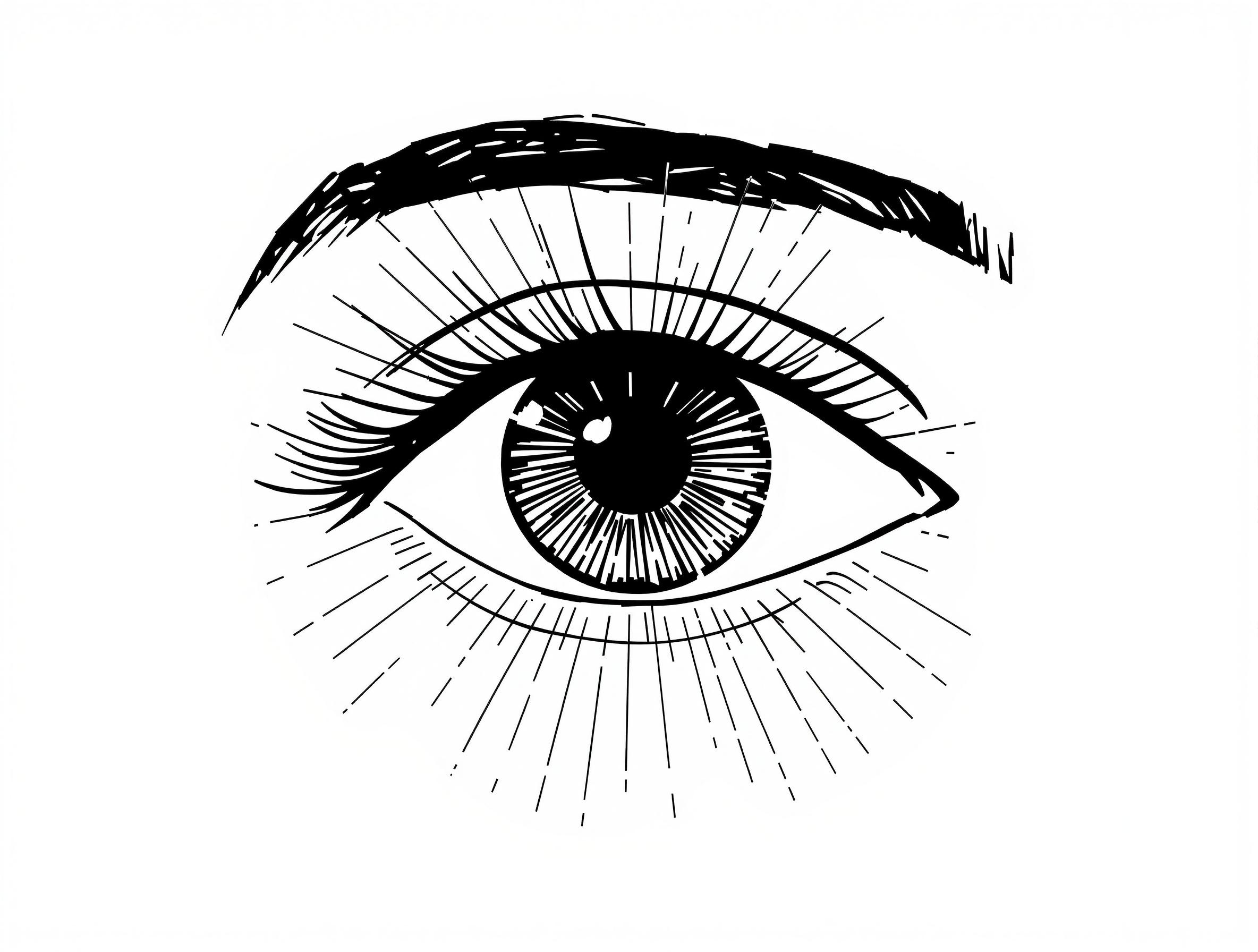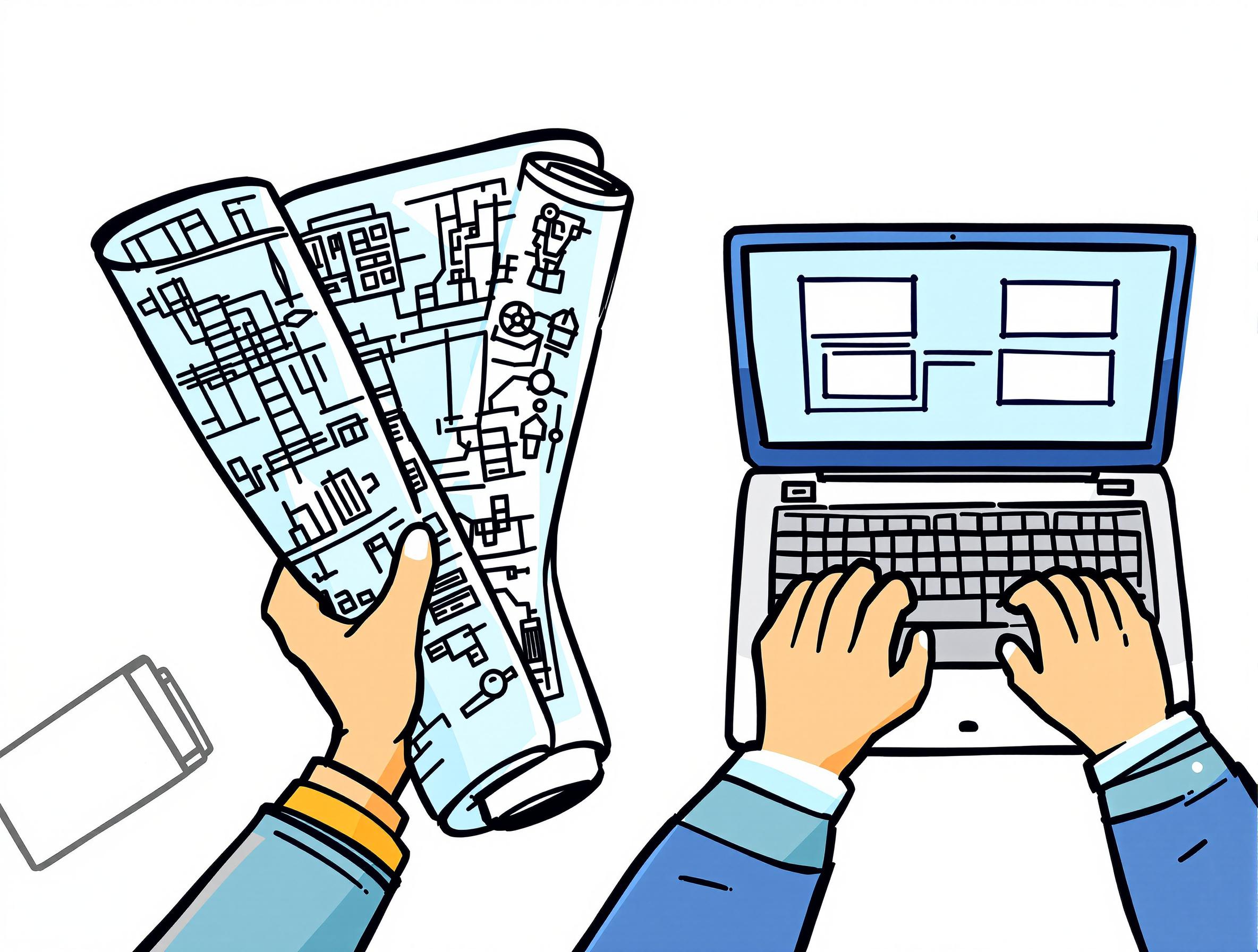Pour finir en beauté cette semaine de démystification : les « capacités émergentes » – le terme qui transforme les effets d’échelle en magie computationnelle.
Le narratif est séduisant : quand les systèmes d’IA grossissent, ils développent spontanément des capacités que personne n’a programmées. Des aptitudes « émergent » de la complexité comme la conscience naîtrait de la matière.
Bullshit total.
Voici la réalité : franchissement de seuils d’utilisabilité.
Tout système computationnel a des capacités qui existent mais sont en deçà de niveaux de qualité utiles. Quand vous ajoutez plus de paramètres, de données d’entraînement et de puissance de calcul, certaines de ces capacités passent de « techniquement possible mais inutile » à « réellement fonctionnel ».
Les capacités n’émergent pas – elles étaient toujours mathématiquement possibles dans l’architecture du système. Elles étaient juste nulles jusqu’à atteindre l’échelle suffisante pour devenir utilisables.
C’est comme prétendre que des « capacités de conduite émergent » quand vous mettez enfin assez d’essence dans votre voiture pour démarrer le moteur. La voiture était toujours capable de rouler – elle avait juste besoin de carburant suffisant pour fonctionner.
Pareil pour l’IA. Les opérations mathématiques pour le raisonnement complexe existent aussi dans les petits modèles. Elles ne sont simplement pas fiables ou utiles jusqu’à atteindre l’échelle suffisante.
Cette semaine, nous avons démonté cinq termes qui mystifient l’ingénierie de base. Le pattern est constant : prendre du progrès technique normal, l’enrober de métaphores biologiques/cognitives, et soudain vous avez des percées révolutionnaires.
Comprendre vaut mieux que mystifier. À chaque fois.